La Place d’Armes du Cap-Haïtien

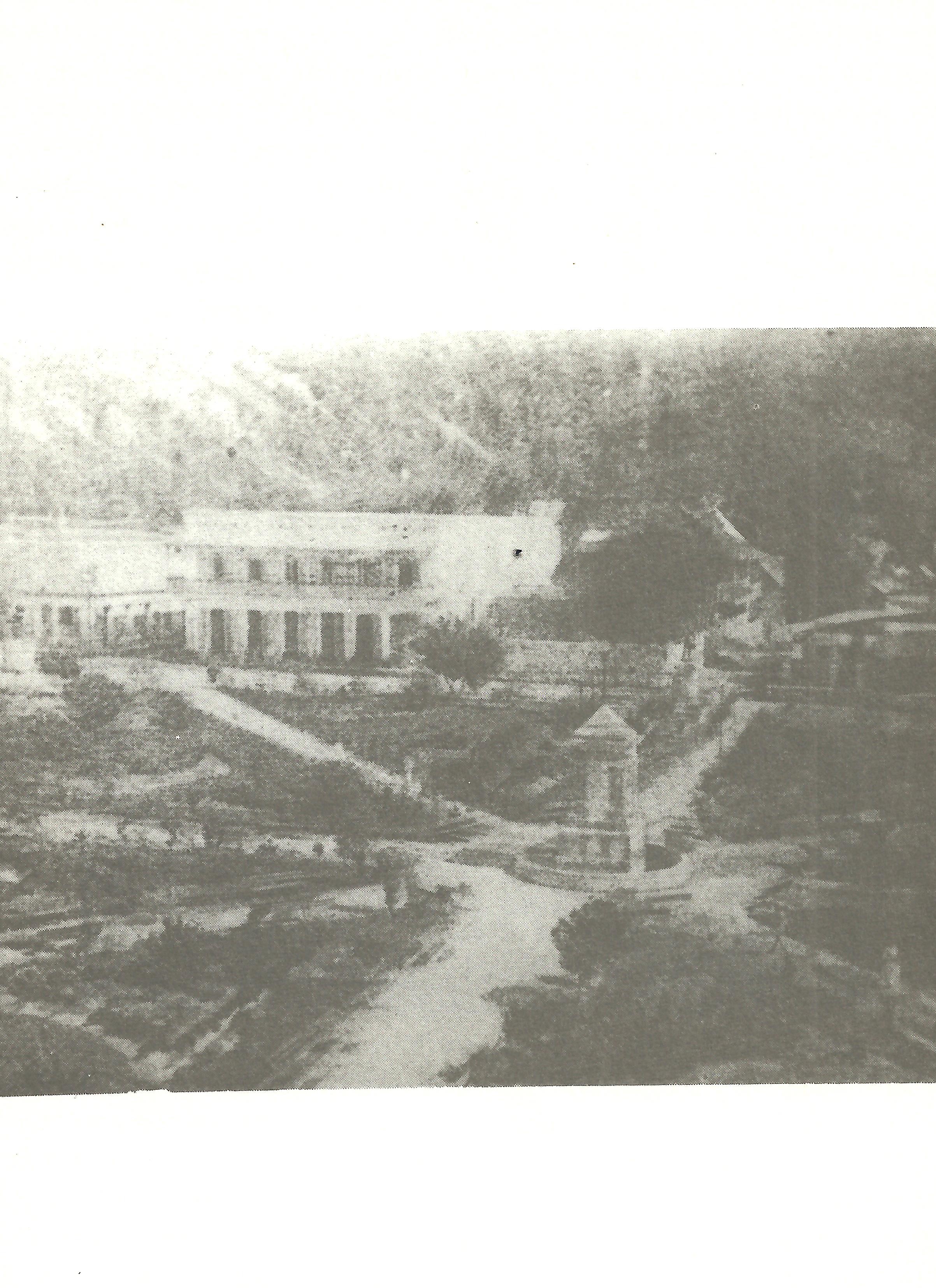
À l’époque coloniale, la Place d’Armes du Cap qui a porté aussi le nom de Place Notre-Dame, à cause de la position de l’église, consiste en un carré de 45 toises (1) auquel se joint les quatre rues qui la bordent : rue du Morne des Capucins (rue H) à l’Ouest, la rue Dauphine à l’Est (rue F), la rue Notre Dame (rue 18) au Sud, au Nord, elle prend de l’expansion par l’ouverture de la rue Bourbon (rue 20). Elle est décorée par le portail de l’Eglise à son côté Sud et entourée de toute part par de belles maisons qui l’embellissent. C’était au début un espace irrégulier, laissé libre autour de l’église sans aucune fonction précise, on ne commença à l’utiliser qu’à partir de 1706, dans la partie contiguë à l’église comme un marché ; par la suite on y établit un Corps de garde, d’où le nom de Place d’Armes attribué aussi à cet enclos.
Le 7 février 1707, un arrêt du Conseil du Cap établit en face de l’église un marché de comestibles ; ce marché survivra jusqu’au 30 juin 1736, date à laquelle une ordonnance du juge de police en fit deux marchés et transféra l’un à la rue Espagnole et l’autre à la rue de la Fontaine (rue 19). Cinq ans après, le 26 juin 1741, une ordonnance du même juge renvoya le marché, de la rue Espagnole à la Place d’Armes, à cause du danger que présentait le passage continuel des voitures aux voyageurs, acheteurs et vendeurs ; on le plaça au Nord-Ouest de la Place, le long du morne des Capucins. Ce nouveau marché attira également les vendeurs de marchandises sèches, ils y furent cependant expulsés par l’ordonnance du 23 avril 1742.
En 1744, on bâtit une église de bois à proximité du marché du morne des Capucins au Nord-Ouest de la Place, à l’endroit où se trouve aujourd’hui l’Évêché ; pour ne pas nuire à la tranquillité de l’office divin, la police fit transférer le marché des denrées, le 25 mai 1744, au côté Est de la Place. À la même époque, les pacotilleurs qui étaient expulsés du marché en 1742, sachant que l’obstination est la clé du succès, revinrent à la Place d’Armes ; la police fut complaisante cette fois-ci, on y vit apparaitre, à ce moment, le petit marchand à inventaire, le porte-balle, puis les boutiques mobiles et enfin les boutiques à roulettes supposées mobiles, mais trop grandes pour être ambulatoires ; selon une ancienne coutume, le dimanche, les nègres avaient la permission de vendre leurs denrées le long de la rue Dauphine (F). La Place d’Armes fut embellie par la plantation d’arbres en double rangées sur les côtes Est et Ouest ; à cette décoration s’ajouta tout naturellement l’ombrage frais de ces arbres.
Les commerçants qui se trouvaient au marché des Blancs, convaincus de la beauté de cet emplacement, osaient maintenant s’aventurer à la Place d’Armes, les deux marchés ainsi réunis, le dimanche et les jours de fêtes, les marchands organisaient une foire qui s’étendait de la Place d’Armes à la rue Neuve (rue B) en descendant le long de la rue de La Fontaine (rue 19). Au marché des Blancs, l’on pouvait trouver toutes sortes de marchandises sèches et de comestibles importés de France, et aussi des bijoux, des souliers, des chapeaux, des perroquets, des singes, des ferrailles, des poteries, de la faïencerie et mercerie. Le marché des Blancs était le favori de tous ceux qui voulaient se procurer toutes leurs marchandises en une seule place ; c’était aussi le site des commérages et des nouvelles de toutes sortes, les femmes de couleur s’y rendaient pour étaler leur luxe, un appât qu’elles savaient employer avec succès nous dit Moreau de Saint-Méry.
Mais le 11 mars 1763, une ordonnance de police renvoya les commerçants du marché des Blancs à la rue Neuve (rue B), seuls ceux qui avaient une possession d’habitude et des places fixes étaient autorisés à rester à la Place d’Armes. Le 12 septembre 1764, le bureau de police municipale imposa une perception fiscale pour tous les marchands :
« Chaque boucher de mouton et cochon et chaque marchand de toile, quincaillerie et graisserie au premier et deuxième rang des rues payait 12 livres par mois et tous les autres ainsi que les boulangers 9 livres par mois, sous peine d’expulsion hors de la place ».
Il faut aussi noter qu’au milieu de la Place d’Armes existait aussi une magnifique fontaine, qui sera remplacée dans la période haïtienne par la statue de l’empereur Jean-Jacques Dessalines. Cette fontaine fut construite par étapes pour répondre au manque d’eau potable pour les résidents de la ville, les habitants, nous dit Moreau de Saint-Méry, étaient obligés d’aller chercher l’eau à une source dans le morne situé au Nord-Ouest de la ville. À cause de ces inconvénients, il y eut à l'Assemblée Coloniale, le 10 mars 1710, une convocation des différents administrateurs à propos de l’érection d’une fontaine, pour répondre au besoin de la population. Pour défrayer les dépenses, une taxe de dix sous fut imposée sur chaque bannette de cuir de bœuf qui serait embarquée au Cap. Près de dix ans après, en 1719, il n’y eut toujours pas de fontaine, la perception sur le cuir n’était pas suffisante, l’Assemblée coloniale formée pour l’octroi des fonds, trouvant cette entreprise trop dispendieuse, refusa toute contribution au projet.
Enfin la fontaine apparut en 1735, c’était un simple bassin de pierres surmonté d’une énorme cage de bois aux quatre côtés de laquelle se trouvait un robinet. Ce monument ne fut pas des plus attrayants, il fut remplacé en 1769 par une nouvelle fontaine construite sous la conduite et les plans de l’ingénieur M. de Rabié, trente ans après que M. de Fayet, Gouverneur général à l’époque, eut recommandé la construction d’une fontaine de pierres pour remplacer cette cage en bois qui défigurait la Place d’Armes.
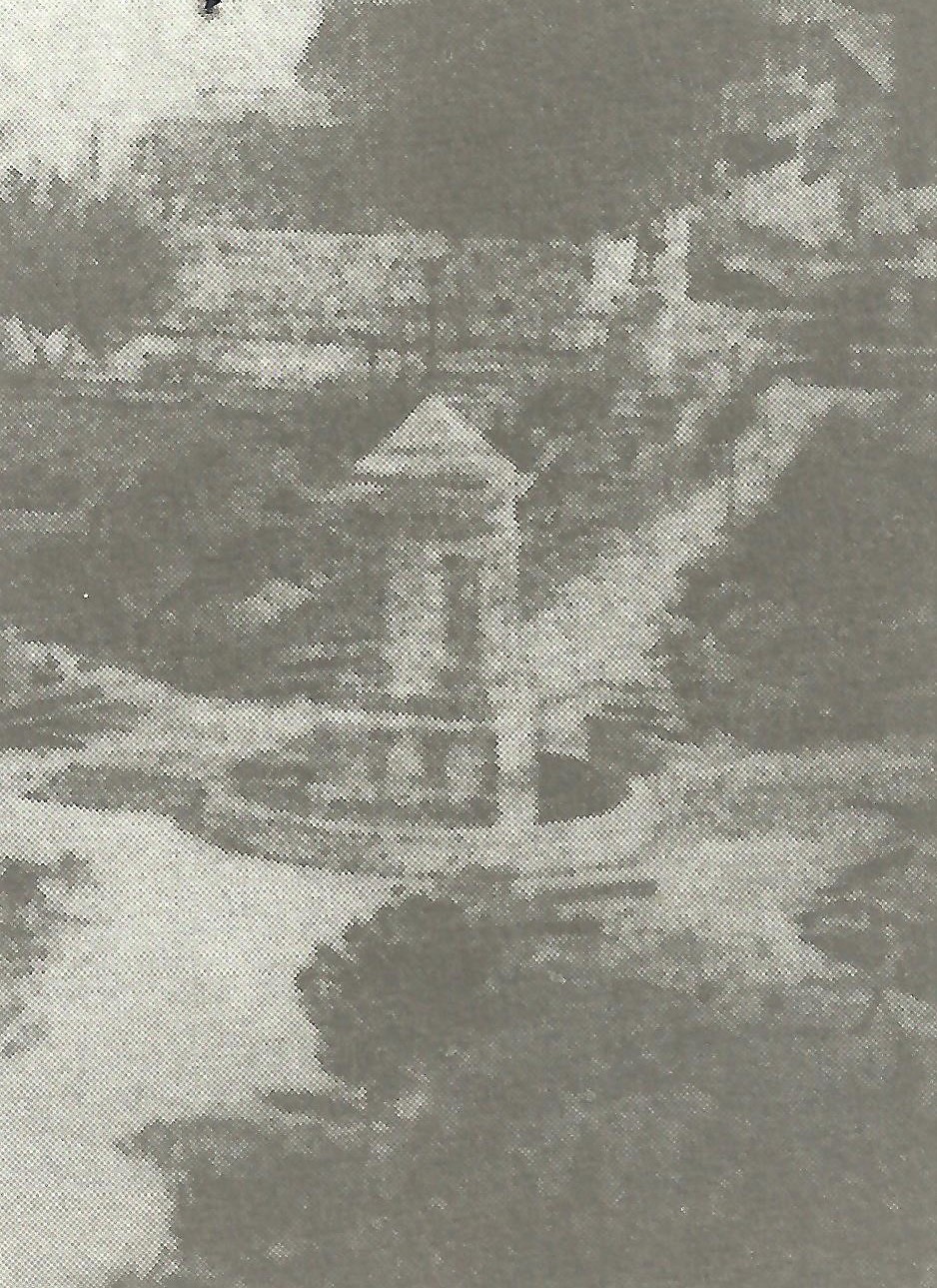
Voici comment Moreau de Saint-Méry décrit cette nouvelle fontaine :
« Une belle fontaine de pierre composée d’un socle de six pieds en carré au-dessus duquel est un piédestal coupé sur les angles, dont les quatre faces sont creusées circulairement. […]
Au-dessous est un autre petit socle, sur lequel est posé un vase antique couronné de deux dauphins. […]
Au Sud se trouve les Armes de la ville du Cap.
À l’Est les Armes de M. Le Prince de Rohan.
À l’Ouest, celles de M de Bongars, Intendant.
Sur la face Nord du piédestal sont sculptées les Armes du roi avec cette inscription :
Regnante Ludovico XV, amatissimo
Impensis Regis
Fons exurgit civibus
Sous le règne du très bien-aimé Louis XV
Une fontaine a été érigée pour les citoyens
Grâce à la générosité du roi
Le Cap-Français dès sa fondation a toujours eu une garnison militaire formée de détachements de troupes de la marine ; vers 1718, ces troupes furent tellement réduites qu’on dut faire appel à des milices pour monter la garde le soir. Les milices sont aussi anciennes que la colonie puisque les premiers Français arrivèrent à la Petite Anse les armes à la main, ayant à leur tête des chefs qu’ils avaient eux-mêmes choisis. Supprimées en 1764, elles furent rétablies par une ordonnance du roi, quatre ans plus tard, en 1768, avec un commandant, un major, un aide major et des milices de chaque paroisse. Pendant longtemps, les milices ne portaient pas d’uniformes, les officiers ou haut-gradés ne se distinguaient des simples soldats que par leur hausse-col, l’une des plus anciennes décorations. Parmi les divers groupes on retrouve : une compagnie de grenadiers, une de carabiniers, une compagnie de dragons à pied et de dragons à cheval et enfin des gendarmes. Les milices du Cap se sont distinguées en plusieurs occasions par leur zèle et leur courage. D’après le bureau de recensement, pour l’année 1788, on comptait 1600 milices pour la seule ville du Cap.
L’ancien Corps de garde du Cap se trouvait dans la huitième section de la ville, on le transporta près du quai en 1719, à l’immeuble abritant le magasin du roi ; par la suite, on le transféra en face de l’arsenal, puis sur le morne des Capucins, à l’angle des rues Saint-Laurent (21) et du Palais (G). Enfin, après l’aplatissement du Morne des Capucins, on construisit à la Place-d’Armes, en 1724, une baraque de bois pour abriter le Corps de Garde, elle servait en même temps d’arsenal et de résidence pour les soldats. Cette baraque était située à l’opposé de l’église et s’étendait jusqu’à la rue du Palais (rue G), elle était entourée d’une haie ; au milieu se trouvait le lit des soldats, à l’ouest la chambre de l’officier et à l’est le lieu de détention, quatre arbres, plantés devant l’immeuble, apportaient de l’ombre aux soldats en été. La Place d’Armes eut donc une double fonction, elle servit de marché et d’arsenal. En 1779, la Place fut nivelée et limitée par une enceinte formée de traverses de bois équarri, portées par des poteaux de distance en distance, et sur lesquelles on pouvait s’asseoir, cette clôture était peinte de vert, ce qui ajouta un peu de vivacité à la Place d’Armes.
À l’époque coloniale, la Place d‘Armes est l’endroit où l’on passe les milices en revue, c’est aussi le lieu des exécutions. Cette place a été, durant cette période, le théâtre de remarquables tragédies : En 1758, Mackandal, leader de différentes bandes de Marrons qui descendaient des mornes la nuit pour inciter les esclaves à la violence contre les Blancs et piller leurs plantations, fut brulé vif sur la Place d’Armes, sur l’ordre de la Commission Prévôtale. Le 25 février 1791, le supplice de la roue fut imposé à Vincent Ogé et Jean-Baptiste Chavannes, deux mulâtres qui combattaient pour l’égalité politique avec les blancs. Vingt-et-un de leurs compagnons furent condamnés à la pendaison et treize autres aux galères ; deux jours après leur exécution, un autre fut rompu vif.
C’est aussi sur cette place que fut exposé le 11 novembre 1791, le corps du Père Philémon, curé de la paroisse du Limbé, qui avait servi comme aumônier dans l’armée de Biassou. Parce qu’il avait osé manifester de la sympathie à la cause des Noirs, il fut condamné à mort par pendaison en présence d’un grand nombre de citadins rassemblés pour la circonstance. Pour démontrer le lien qui existait entre l’aumônier et les Noirs, on exposa à côté de son cadavre, la tête de Dutty Boukman, exécuté quatre jours avant, le 4 novembre 1791 ; ce dernier fut l’organisateur de la cérémonie du Bois Caïman, prélude de la grande révolution qui aboutira à l’indépendance de notre pays.
Après l’exécution du Père Philémon, Biassou organisa un service funéraire en l’honneur de son aumônier, qu’il considérait comme un martyr pour la cause des Noirs et un messager de Dieu. Les vêtements que le prêtre avait laissés au camp furent coupés en morceaux et chaque soldat en porta un sur lui comme talisman. Quoique l’Église catholique ait supporté l’esclavage, certains prêtres missionnaires refusèrent d’accepter le statut quo et s’alignèrent du côté des insurgés, invoquant l’égalité de tous devant Dieu, utilisant déjà le langage de la théologie de libération du vingtième siècle. À part le Père Philémon, on peut citer parmi d’autres victimes : Le Père Cachetan, l’Abbé Guillaume Sylvestre Delahaye, l’Abbé Bienvenu Amonet, l’Abbé Aubert, l’Abbé Jérôme Blacé, le Père J.P.M. Blouet, le père Ménétrier, l’Abbé Ouvrière, tous défendeurs de « la bonne cause ». Quelques-uns perdirent leur vie aux mains des autorités coloniales, d’autres furent emprisonnés.
Durant la révolte des esclaves en 1791, la Commission prévôtale, sous la direction de l’Assemblée Coloniale, établit en permanence deux échafauds et cinq potences au Cap-Français sur la Place d’Armes ; vingt à trente prisonniers noirs perdirent la vie chaque jour durant l’insurrection, ceux que les blancs épargnèrent étaient marqués sur la joue à l’aide d’une étampe à feu portant la lettre R, c’est-à-dire révolté. Certains noirs eurent la tête tranchée, d’autres furent brulés vifs. Même les militaires ne furent pas épargnés comment l’indique ces deux récits racontés par un témoin :
Le premier est celui d’un jeune officier de navire de Bordeaux condamné à la potence pour vol avec effraction, le 14 mars 1777. Au moment où le bourreau s’’apprête à exécuter la peine, la corde se rompt, le malheureux prisonnier se relève promptement, se met à genoux et crie grâce ; quelques voix dans la foule répètent grâce […] le bourreau se bat avec l’officier qui le mord et lui lance des coups de pieds […] lorsque deux vigoureux matelots saisissent le bourreau, le frappent et lui enlèvent le prisonnier. Le bourreau tente de regagner la prison où il habite, mais des Nègres le poursuivent, le lapident et le font tomber mort sur l’autre côté de la Place-d’Armes, nous dit le témoin :
« J’ai vu le corps de ce malheureux sous un amas de pierres ; sa tête était absolument aplatie. Un fait singulier, c’est qu’une petite souris qu’il avait eu la patience d’apprivoiser et qui était dans sa poche, y fut trouvée vivante. »
La seconde exécution, qui eut lieu le 8 mai 1778, est celle d’un grenadier et d’un caporal du régiment de Gatinois, condamnés au supplice pour cause d’assassinat. Comme on avait fait courir le bruit qu’un groupe de grenadiers avaient l’intention de sauver leurs camarades, on fit mettre 300 hommes formés des divers corps de la garnison, en bataillon carré, autour de l’échafaud. Au premier coup de barre donné au grenadier sur une jambe, il pousse un cri aigu […] Des femmes spectatrices en sont émues, elles s’agitent pour s’éloigner ; ce mouvement est pris pour celui de la révolte qui doit sauver les criminels ; la troupe fait feu, se débande, poursuit les spectateurs et les passants. Vingt-huit personnes furent tuées ou moururent plus tard de leurs blessures. Entretemps, le bourreau, se rappelant le sort de son camarade l’année précédente, procéda sans délai á l’exécution.

Trop de sang a coulé sur cette Place. Ah ! Si les monuments et les places publiques pouvaient nous confier leurs secrets, ils en diraient long ; l’histoire est remplie de ces incidents qui mettent à nu l’imperfection humaine, de Caïn à nos jours. Les monuments, les statues, les places publiques reflètent l’époque de leur création ; mais ils sont réinterprétés par les nécessités urbaines des époques suivantes et par le dynamisme des dirigeants, leur fonction varie, comme l’indique l’histoire de la Place d’Armes. Ce grand carré en face de l’église est aujourd’hui une place communale où domine la statue de l’empereur Jean-Jacques Dessalines, tenant d’une main l’acte de l’indépendance, de l’autre le drapeau haïtien, veillant constamment sur le patrimoine qu’il nous a légué.
De grands travaux de rénovation ou de construction ont été entrepris pour la réhabilitation de la Place de la Cathédrale et des immeubles situés aux alentours. Ainsi dans les années 40, on vit l’érection du bureau de la Commune (Mairie) et du bureau de la Préfecture, ce dernier abritant aussi une bibliothèque au premier étage. La Cathédrale du Cap-Haïtien, entièrement détruite le 7 mai 1842, lors du séisme qui bouleversa la ville entière, ne fut complètement restaurée que cent ans après en 1942, car les travaux de reconstruction, pour des raisons économiques, furent excessivement lents. Elie Lescot, président de la République à l’époque, procéda à l’inauguration de la nouvelle Cathédrale. À partir de cette date, la Place d’Armes reçut aussi le titre officiel de Place Notre-Dame ou Place de la Cathédrale, mais ces noms sont interchangeables.
Ainsi, entourée du Presbytère au sud- Est, de l’église Notre-Dame au sud, de l’Union Club à la rue 18 H, de la Préfecture et l’Évêché à l’ouest et de la Mairie au nord, la Place Notre-Dame devint l’épicentre des administrations civiles, sociales et religieuses. L’embellissement plut énormément aux Capois.
De mon temps, cette Place fut le focus de toutes les activités importantes :
<
La Place vue de la Mairie, circa 1960. (On y note en bas, à gauche, une partie du kiosque)
Par exemple, le premier janvier, date de la commémoration de notre indépendance, des gens de tout âge accouraient à la Place de la Cathédrale pour écouter la fanfare de l’Arsenal jouer le « ochan » pour les autorités civiles, militaires et religieuses, à leur sortie de l’église, après le Te Deum ; ces musiciens continuaient d’entretenir les assistants même après le départ des dignitaires. Aussi le 15 août, date anniversaire de l’armée, était fêté avec pompes et circonstances, cette date marque le départ des marines et le début de notre seconde indépendance. On voyait ce jour-là défiler un nombre important de soldats et de hauts gradés marchant au pas militaire, tête haute et torse « bombé » ; cette grande parade, si je m’en souviens après tant d’années, partait de l’Arsenal, faisait le tour de la Place Notre-Dame avant de remonter la rue 20 pour enfin arriver au Champ-de-Mars. À cette occasion, la Place était bondée de gens, attirés par la prouesse des soldats.

Le dimanche, après la grand-messe, les jeunes se rassemblaient, en grand nombre, à la Place Notre Dame pour causer et s’amuser en attendant l’ouverture de la Salle Paroissiale où la Troupe Comique, formée d’un groupe d’élèves du lycée Philippe Guerrier et du Collège Notre-Dame, offrait au public des représentations théâtrales où l’on retrouvait un peu de tout : danses folkloriques, monologues et des pièces sur les mœurs et les coutumes du pays. Construite au début des années cinquante ou fin quarante, la Salle Paroissiale était mise à la disposition des écoles pour toutes activités scolaires et aussi pour des récitals à l’occasion de la fête des Mères et celle du drapeau le 18 mai ; c’était aussi le local des guides de la compagnie Jeanne d’Arc.

Au sud-Est de la Place, à côté de l’église, se trouvait le Ciné Eden qui faisait le délice des jeunes, car le prix était abordable, cinquante centimes en matinée, deux films pour cinquante, le vendredi. Quelle aubaine ! Le grand écran fut pour moi personnellement une échappatoire qui me permettait de m’évader dans un monde différent. Les jeunes qui ne pouvaient pas se payer le luxe d’un billet d’entrée se rassemblaient le dimanche à la Place Notre-Dame, en face du Ciné, pour commenter sur l’accoutrement des cinéphiles ou pour admirer les jeunes filles à la sortie de l’église après les vêpres, une façon de se défouler.
J’ai de bons souvenirs de la Place Notre Dame. C’était l’endroit où les jeunes de ma génération se rencontraient les jeudi et dimanche soir pour les concerts ou pour les retrouvailles, durant les grandes vacances. C’était aussi une oasis où des gens de tout acabit se rendaient pour échapper à la canicule de l’été, profitant de la brise que procurait ce vaste espace. Devant le presbytère, à côté de la Place, les marchandes, étalaient leurs friandises dans des bacs bien achalandés ; on avait le choix entre les douces de coco, de lait ou de noix, les bonbons d’amidon, les gingembrettes, le sucre à la menthe, titato, piroulis et des chicklets… En passant au coin de la rue 20 F, le jeudi soir, l’odeur des pâtés et des friandises de madame Vivic faisait venir l’eau à la bouche.
Le dimanche soir, un monde hétéroclite, hommes et femmes affichant leurs habits de circonstance, défilait autour de la Place : des amoureux, des convalescents, des amateurs de musique, des jeunes et des vieux, tous attirés par le rythme entrainant de la fanfare de l’Arsenal. Comme il n’y avait pas suffisamment de bancs pour accommoder tous les assistants, les jeunes et les moins jeunes faisaient le tour de la Place en causant et les passionnés de musique se rangeaient autour du kiosque, abritant la fanfare, pour mieux savourer les notes.

Située en face de l’église, la Place Notre-Dame attirait également le grand public lors des mariages, des processions religieuses, du carnaval et même des funérailles de gens soi-disant importants, les commérages fusaient de toute part en ces occasions ; lors de la visite au Cap-Haitien de Claudinette Fouchard, couronnée reine au concours mondial du sucre à Cali, en Colombie, les jeunes gens se bousculaient pour trouver un endroit où ils pourraient mieux admirer cette séduisante beauté, avant de se rendre en toute hâte à la rue Espagnole, poursuivant le parcours du défilé.
Comme toutes les places publiques, la Place Notre-Dame, poumon de la ville, servait de lieu de convergence pour des activités de tous genres : promenade, jeux, rassemblement, discussions, rendez-vous, concerts etc. offrant ainsi un sens d’appartenance à tous les Capois, un véritable espace physique pour la mixité sociale. Comme le dit Fred Kent, président et membre fondateur du Project for Publics Spaces :
« Un véritable espace public de qualité est celui que l’on a envie de fréquenter régulièrement et où l’on tisse des liens avec d’autres personnes ».
Ainsi, la Place Notre-Dame de ma jeunesse a rempli cette mission : celle d’offrir aux enfants l’opportunité de se faire de nouveaux amis, lors de leurs rencontres et aux adultes un lieu de détente, de rassemblement, un éden où ils peuvent librement échanger leur point de vue sur certains sujets et se soutenir mentalement, sorte de thérapie salutaire pour la communauté.
Les jeunes d’aujourd’hui ont naturellement des expériences différentes de la mienne, car l’expérience est non seulement personnelle mais aussi générationnelle. La Place a subi des transformations physiques au cours des années, ces modifications ne laissent aucune empreinte sur ma psyché, parce qu’elles ne sont pas enregistrées dans mon subconscient. C’est toujours à la Place Notre-Dame de mon enfance et adolescence que je pense quand la nostalgie m’envahit et qu’il m’est absolument nécessaire de retrouver mon essence.

Notes:
(1) 1 toise= 1,949 mètre.
Marie-Thérèse Méhu-François
Sources :
Beaubrun Ardouin. Études sur L’Histoire d’Haïti, tome I-V. Paris, Dezabry, 1853.
Médéric-Louis-Elie Moreau de Saint-Méry. Description de La Partie Française de L’Isle de St Domingue, tome I. Philadelphie, 1797.
Terry Rey. The Priest and the Propheters: Abbé Ouvrière, Romaine Rivière, and The Revolutionary Atlantic World. Oxford, Oxford University Press, 2017.