À propos du livre : Le gouvernement du roi Henri Christophe
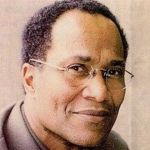
Note de la rédaction
Nous reproduisions ici un compte-rendu du livre de Hénock Trouillot, Le gouvernement d'Henri Christophe par Maximilien Laroche, paru en 1974 mais dont le contenu demeure tout à fait actuel dans le contexte de crise de gouvernance que traverse le pays.
Le dernier ouvrage de l'historien Henock Trouillot, vient combler une lacune. En effet, par un de ces paradoxes qui ne se comptent plus, quand il s'agit d'Haïti, le personnage du roi Christophe a été plus souvent étudié en dehors d'Haïti que par les écrivains haïtiens. Dans le nord du pays, là où fut établi «le royaume d'Haïti», la mémoire du bâtisseur de la Citadelle Laferrière, continue d'être l'objet d'une grande vénération. Mais c'est à l'étranger (Angleterre: Hubert Cole; États-Unis: Eugène O'Neill; Antilles: Derek Walcott, Aimé Césaire...) surtout que le souvenir de ce personnage important de l'histoire haïtienne a fait l'objet d'essais, de pièces de théâtre.
Depuis le monumental ouvrage de Vergniaud Leconte sur le roi Christophe, paru il y a maintenant une quarantaine d'années, le destin du roi Christophe a fait plutôt l'objet de polémiques parmi les historiens haïtiens, quand il n'a pas été relégué au second plan au profit d'études consacrées en majorité à Toussaint Louverture. L'ouvrage d'Henock Trouillot vient donc, à son heure, réparer cet oubli ou cette indifférence. Cette tâche est d'ailleurs menée avec tout le sens de la mesure et la solidité de la documentation qu'il fallait. On sait bien que Henri Christophe, ancien esclave et compagnon d'armes de Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines, seconda ce dernier dans la lutte de libération nationale que menèrent les Haïtiens contre les soldats de la France bonapartiste. Après la mort de Dessalines, premier chef de l'état indépendant d'Haïti, Christophe accéda au pouvoir, mais par suite de l'opposition d'une importante fraction de la classe dominante qui avait comploté la mort de Dessalines, il dut établir son gouvernement dans la partie septentrionale du pays. Sur ce « Royaume d'Haïti », le mécanisme de son fonctionnement, les conditions de sa viabilité, sur la portée générale des mesures administratives, politiques et économiques que prit le roi Christophe, tout l'éclairage est loin d'avoir été fait. Et l'entreprise d'Henock Trouillot, en étudiant «le gouvernement du roi Christophe» consiste à lever un premier voile sur ce moment décisif de l'Histoire haïtienne.
Si l'action du roi Christophe a semblé davantage frapper l'attention des observateurs hors d'Haïti que des analystes haïtiens, cela tient sans doute à cette attitude polémique qui a continué de partager les écrivains haïtiens en fils spirituels de Pétion ou de Christophe et qui perpétuait ainsi l'opposition des deux chefs qui se partagèrent le pouvoir au lendemain de l'indépendance. Mais cela tient peut-être davantage encore au fait que le destin du roi Christophe ne peut être considéré et envisagé, dans toute son ampleur, que dans le cadre de l'histoire de la décolonisation d'Haïti et que, pour parler en terme de «culte de la personnalité », on ne peut séparer les trois chefs qu'ont été Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe. Parler du premier, qui organisa la lutte pour l'indépendance, c’est s'obliger à considérer l'action du second qui réalisa cette indépendance et du même souffle c’est devoir étudier le défi qu'eut à relever Henri Christophe, quand il entreprit de donner à cette jeune indépendance haïtienne les indispensables assises administratives, économiques, politiques et diplomatiques dont elle avait besoin. Car ce n'était sans doute pas une tâche simple en 1807 que de préserver la liberté nouvellement conquise par Haïti dans ce concert de nations esclavagistes et colonialistes franchement hostiles à cet État, que venaient de créer d'anciens esclaves nègres révoltés contre leurs maîtres européens.
Il revient au poète et essayiste martiniquais, Aimé Césaire, d'avoir, avec le plus de force et d'éloquence, mis en évidence la tâche titanesque de Christophe, dans sa pièce de théâtre «la tragédie du roi Christophe». Et que l'on ne s'étonne pas de voir ici un poète et homme de théâtre figurer à titre d'historien. La pièce de Césaire, œuvre de fiction nourrie cependant de la connaissance la plus intime du drame profond des peuples antillais, est la suite logique de son essai historique sur Toussaint Louverture. Nulle part autant que chez les peuples en train de se décoloniser ne se vérifie autant l'idée que développait Roland Barthes dans un texte sur le discours de l'histoire, à savoir que de l'histoire (dite scientifique et objective) à cette histoire (dite fictive et subjective) il n'y a pas vraiment de différence de nature mais d'idéologie. Les peuples en voie de décolonisation doivent passer par le rêve d'une autre histoire pour découvrir le mécanisme et le sens objectifs de cette histoire qu'on leur impose. Henock Trouillot, admirateur et biographe de Césaire, le sait bien. Et si son livre est modeste dans ses objectifs et son champ d'étude, il ne prétend pas embrasser tout le destin du roi Christophe ; il ne procède pas moins avec méthode et sûreté à cette tâche indispensable qui consiste à exposer les méthodes de gouvernement du roi Henri Christophe.
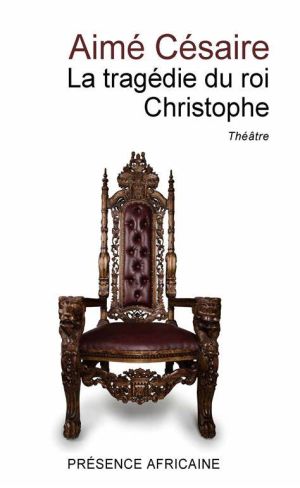
Avec une abondance de détails qui n'exclut pas une grande pondération dans le jugement, et surtout cette absence de partialité qui a souvent caractérisé les historiens du roi Christophe, Henock Trouillot nous permet d'entrevoir, en arrière-plan de la machine gouvernementale de Christophe, le dessein qui animait ce dernier. Car si le roi Christophe était forcé de répéter les modèles contemporains de gouvernement, qui s'offraient à lui, il n'était pas moins soucieux de faire preuve d'originalité et d'innover. Du mode de perception des impôts à l'organisation du commerce extérieur en vue d'équilibrer la balance des paiements du royaume, mais, également, dans le but de nouer des alliances et de se ménager des armes pour une double guerre (à l'intérieur et à l'extérieur d'Haïti), la politique du roi Christophe nous apparaît comme un vertigineux exercice d'équilibre sur la corde raide au-dessus d'une fosse aux lions.
